| |
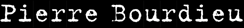
« An
Antinomy in the Notion of Collective Protest », in Development,
Democracy, and the Art Of Trespassing : Essays
in Honor of Albert 0. Hirschman, A. Foxley, M.S.
McPherson, C. O'Donnell eds, Notre Dame (Indiana), University of Notre
Dame Press, 1986, Paperback edition, 1988, p. 301-302.
Repris dans : Propos sur le champ politique, PUL, Lyon,
2000, pp. 89-91
Mots-clefs : exit;
voice; loyalty; délégation; action collective; volonté générale; porte-parole;
parole commune; Hirschman
|
|
| |
 e choix de la désertion ou de la protestation,
exit ou voice, n'apparaît comme une alternative tranchée
qu'aussi longtemps que l'on reste dans la logique de l'action individuelle
(1). Les institutions spécialement aménagées
pour exprimer les revendications, les aspirations, les protestations
fournissent une troisième voie : le porte-parole est une
voix autorisée, forte de l'autorité d'un groupe. À l'organisation,
qu'il s'agisse de l'entreprise qui vend un lemon (mauvais produit)
ou qui licencie ou de tout autre pouvoir institué, il oppose une organisation,
parti, syndicat ou association, chargée, au moins officiellement,
de la défense collective des intérêts individuels de ses membres.
Grâce à la technologie sociale de la délégation qui dote le mandataire
de la plena potentia agendi, le groupe représenté se trouve
constitué comme tel : capable d'agir et de parler « comme
un seul homme », il peut mobiliser toute la force matérielle
et surtout symbolique dont il dispose à l'état potentiel. La protestation
impuissante ou la désertion insignifiante de l'individu isolé, formes
diverses de l'action sérielle, celle du vote ou du marché, qui ne
devient efficace que par l'effet des mécanismes aveugles et parfois
pervers de l'agrégation statistique, cède la place à une protestation
à la fois unitaire et collective, cohérente et puissante. Ceci du
moins selon les représentations non moins mythiques que la tradition
progressiste n'a cessé d'opposer au mythe de la « main invisible »,
et qui sont autant de variantes de la figure rousseauiste du « Législateur »
capable d'incarner et d'exprimer une « volonté générale »
irréductible à la « volonté de tous » obtenue par simple
sommation des volontés individuelles. e choix de la désertion ou de la protestation,
exit ou voice, n'apparaît comme une alternative tranchée
qu'aussi longtemps que l'on reste dans la logique de l'action individuelle
(1). Les institutions spécialement aménagées
pour exprimer les revendications, les aspirations, les protestations
fournissent une troisième voie : le porte-parole est une
voix autorisée, forte de l'autorité d'un groupe. À l'organisation,
qu'il s'agisse de l'entreprise qui vend un lemon (mauvais produit)
ou qui licencie ou de tout autre pouvoir institué, il oppose une organisation,
parti, syndicat ou association, chargée, au moins officiellement,
de la défense collective des intérêts individuels de ses membres.
Grâce à la technologie sociale de la délégation qui dote le mandataire
de la plena potentia agendi, le groupe représenté se trouve
constitué comme tel : capable d'agir et de parler « comme
un seul homme », il peut mobiliser toute la force matérielle
et surtout symbolique dont il dispose à l'état potentiel. La protestation
impuissante ou la désertion insignifiante de l'individu isolé, formes
diverses de l'action sérielle, celle du vote ou du marché, qui ne
devient efficace que par l'effet des mécanismes aveugles et parfois
pervers de l'agrégation statistique, cède la place à une protestation
à la fois unitaire et collective, cohérente et puissante. Ceci du
moins selon les représentations non moins mythiques que la tradition
progressiste n'a cessé d'opposer au mythe de la « main invisible »,
et qui sont autant de variantes de la figure rousseauiste du « Législateur »
capable d'incarner et d'exprimer une « volonté générale »
irréductible à la « volonté de tous » obtenue par simple
sommation des volontés individuelles.
 La mise en question la plus radicale du mythe
fondateur des autorités déléguées vient des situations dans lesquelles
se révèle l'antinomie de la délégation : je ne puis accéder
à la parole puissante, à la voice comme parole légitime, connue
et reconnue, autorisée et dotée d'autorité, qu'en m'exposant à me
trouver dépossédé de la parole, privé d'une expression qui m'exprime
en propre, voire même nié, annulé dans la singularité de mon expérience
et de mes intérêts spécifiques par la parole commune, l'opinio
communis telle que la produisent et la profèrent mes mandataires
attitrés. Ce sont tous les cas où les membres de corporate bodies,
et en particulier de ceux qui sont spécialement aménagés pour
produire et exprimer la protestation et la contestation, comme les
partis, ou les syndicats, se trouvent eux-mêmes placés devant l'alternative
de la désertion ou de la protestation, exit ou voice, en raison
d'un désaccord entre ce qu'ils ont à dire (et qu'ils peuvent découvrir
dans ce désaccord même) et ce que dit la parole autorisée des porte-parole ; et
où ils ne peuvent échapper à l'une ou l'autre forme de l'impuissance
sérielle — celle de la sortie ou de la protestation
individuelle, voire même celle de la pétition destinée à obtenir des
mandants un changement de discours et de politique — qu'en
instituant une nouvelle organisation, exposée elle-même, en tant que
détentrice du monopole de la protestation légitime, à susciter de
nouvelles protestations et de nouvelles désertions hérétiques. Telle
est l'antinomie de l'Église réformée qui, née de la protestation collective
contre l'Église, constitue la protestation en principe d'une nouvelle
église, appelant en tant que telle, la protestation. La mise en question la plus radicale du mythe
fondateur des autorités déléguées vient des situations dans lesquelles
se révèle l'antinomie de la délégation : je ne puis accéder
à la parole puissante, à la voice comme parole légitime, connue
et reconnue, autorisée et dotée d'autorité, qu'en m'exposant à me
trouver dépossédé de la parole, privé d'une expression qui m'exprime
en propre, voire même nié, annulé dans la singularité de mon expérience
et de mes intérêts spécifiques par la parole commune, l'opinio
communis telle que la produisent et la profèrent mes mandataires
attitrés. Ce sont tous les cas où les membres de corporate bodies,
et en particulier de ceux qui sont spécialement aménagés pour
produire et exprimer la protestation et la contestation, comme les
partis, ou les syndicats, se trouvent eux-mêmes placés devant l'alternative
de la désertion ou de la protestation, exit ou voice, en raison
d'un désaccord entre ce qu'ils ont à dire (et qu'ils peuvent découvrir
dans ce désaccord même) et ce que dit la parole autorisée des porte-parole ; et
où ils ne peuvent échapper à l'une ou l'autre forme de l'impuissance
sérielle — celle de la sortie ou de la protestation
individuelle, voire même celle de la pétition destinée à obtenir des
mandants un changement de discours et de politique — qu'en
instituant une nouvelle organisation, exposée elle-même, en tant que
détentrice du monopole de la protestation légitime, à susciter de
nouvelles protestations et de nouvelles désertions hérétiques. Telle
est l'antinomie de l'Église réformée qui, née de la protestation collective
contre l'Église, constitue la protestation en principe d'une nouvelle
église, appelant en tant que telle, la protestation.
 S'agit-il d'une antinomie indépassable, liée
à la nécessité de concentrer le capital symbolique en une seule personne — ou
un petit nombre de personnes — pour lui conférer le
maximum de force ou d'un effet inévitable de la distribution inégale
des instruments de production de la parole, même et surtout critique ? On
ne saurait nier en tout cas que si la parole du porte-parole doit
l'essentiel de sa légitimité, et de sa force, à la reconnaissance
que lui accorde le groupe exprimé, ne fut-ce que le plébiscite forcé
du silence, elle doit une part de cette reconnaissance au fait qu'elle
apparaît comme la meilleure — ou la moins mauvaise — des
transmutations de l'implicite éprouvé en explicite manifesté, publié,
du simple cri de la révolte ou de l'indignation en voix capable de
se faire reconnaître comme telle, c'est-à-dire comme porteuse d'une
part d'universel, et par là d'humanité. S'agit-il d'une antinomie indépassable, liée
à la nécessité de concentrer le capital symbolique en une seule personne — ou
un petit nombre de personnes — pour lui conférer le
maximum de force ou d'un effet inévitable de la distribution inégale
des instruments de production de la parole, même et surtout critique ? On
ne saurait nier en tout cas que si la parole du porte-parole doit
l'essentiel de sa légitimité, et de sa force, à la reconnaissance
que lui accorde le groupe exprimé, ne fut-ce que le plébiscite forcé
du silence, elle doit une part de cette reconnaissance au fait qu'elle
apparaît comme la meilleure — ou la moins mauvaise — des
transmutations de l'implicite éprouvé en explicite manifesté, publié,
du simple cri de la révolte ou de l'indignation en voix capable de
se faire reconnaître comme telle, c'est-à-dire comme porteuse d'une
part d'universel, et par là d'humanité.
Paris, juillet
1984
1.
Albert 0. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty, Responses
to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1970 (2nd Print, 1972).
|
|


