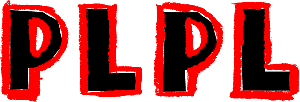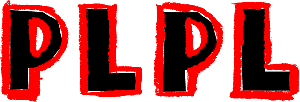| Dans un éditorial plus infatué que d’ordinaire, Jean-Marie Ramina [Colombani, ndlr] « analysait » les raisons du score du Front national au premier tour du scrutin présidentiel : « Ce n’est pas essentiellement une crise sociale ou économique qui fait le lit de ce parti, mais une crise politique, une crise du lien politique dans toutes ses dimensions. […] Cette crise du lien politique se nourrit évidemment d’une crise du lien social et d’une crise du lien national » (QVM, 07.05.02). Satisfait de son « travail », le directeur du Quotidien vespéral des marchés [ex-Le Monde] précisait : « Le diagnostic n’a pas changé par rapport à ce que nous écrivons, dans ces colonnes, depuis bientôt vingt ans ». Ramina n’a pas tort : pour les commentateurs du PPA, toute difficulté sociale, politique ou économique est une « crise ». La « crise », roue de secours du PPA Il n’en fut pas toujours ainsi. Avant d’user de la « crise » comme d’une roue de secours pour gloseurs paresseux, les agents du PPA s’employèrent à vider ce terme de toute connotation subversive. Pour les Sardons, la « crise » du capitalisme devait en effet ouvrir la voie d’une révolution qui balaierait le PPA au profit de la Sardonie libre. Mais à la fin des années 1970, marxistes renégats et essayistes balladuriens jugèrent qu’une révolution menacerait la propreté de leur piscine dans le Luberon. Ce n’est donc plus le capitalisme qui serait en crise. En 1981, l’essayiste mondain Pierre Rosanvallon bâcle un digest des lieux communs des antichambres américaines et l’intitule « La crise de l’État-providence ». Un an plus tard, le journaliste François De Closets caquette son best-seller : « La crise étant indissolublement liée à l’économie de marché, laquelle est non moins indissolublement liée à un certain niveau de vie, nous sommes condamnés à nous en accommoder. 3 » De tremplin pour un bouleversement de l’ordre social, la « crise » devenait l’instrument de sa perpétuation. Ce travail accompli 4, le PPA pouvait enfin hurler « Vive la crise ! », titre d’un supplément de Libération diffusé en février 1984 et d’une émission de télévision. Monté par Alain Minc, le canasson reaganien Yves Montand y expliqua que la crise permettrait de casser les « acquis sociaux », de stimuler les jeunes entrepreneurs (Philippe de Villiers fut cité en modèle) et de donner le pouvoir en Europe à Margaret Thatcher. Le jeune Laurent Mouchard-Joffrin fit chorus, marquant l’histoire de ce néant intellectuel dont il serait par la suite un des plus loyaux interprètes : « La vie est ailleurs, elle sourd de la crise, par l’initiative, par l’entreprise, par la communication. » [voir PLPL 9, p. 6-7] Les deux millions de chômeurs de l’époque apprécièrent plus encore la sortie de l’ancien dirigeant maoïste Serge July, devenu patron de Libération : « Pour rendre la crise positive, il faut faire des citoyens assistés des citoyens entreprenants. 5 » Chez les histrions du PPA, « crise » renvoie à maladie et accident, mais aussi à soudaineté, émotivité, irrationalité. Lors du mouvement de grèves sardones de novembre-décembre 1995, Alain Duhamel diagnostiqua une « grande fièvre collective », François de Closets une « dérive schizophrénique », Alain Minc un « goût du spasme » 6. Les journalistes préfèrent moduler à l’infini la description des symptômes plutôt que d’interroger leurs causes. Quand la dégradation des conditions de vie dans les quartiers populaires laminés par le chômage et la précarité trouva sa traduction médiatique dans le spectacle des voitures brûlées, le PPA invoqua donc un « malaise des banlieues », une « poussée de fièvre ». La « crise de l’autorité » constitua le thème du premier numéro du Koursk [ex-Le Monde des débats], mensuel des abysses intellectuelles. Flairant les poncifs comme un verrat les truffes, Laurent Mouchard-Joffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, fit publier le recueil de ses bavardages avec un petit reptile desséché (PRD) nommé Philippe Tesson. Le sujet ? « Peut-on parler d’une crise générale de l’autorité ? 7 » Réponse du Reptile desséché : « Derrière cette crise de l’autorité se profile une crise de la société, une crise de la vie en commun. » Trois ans plus tôt, le ministre Claude Allègre n’avait-il pas signalé chez les « jeunes des quartiers » une « crise de la citoyenneté » relevant d’une « crise de mutation » 8 ? Une poignée d’experts l’avait aidé, injectant dans les bajoues ministérielles une pâté composite : la « crise du lien social » répondait à une « crise de l’intégration » liée à la « perte de tous les repères moraux et sociaux » 9. Résultat, une « crise des institutions républicaines 10 » menaçait, alimentée par une « crise familiale », une « crise scolaire », une « crise de l’impunité ». Martine Aubry compléta le propos. Nous nous trouvions face à une « crise sociale multiforme » entraînant « peurs et repli sur soi » 11. Tous ces vocables décrivaient les conséquences sociales d’un capitalisme qu’Aubry, Allègre et leurs amis « socialistes » s’emploieraient à dynamiser. Pourquoi tant de « crises » ? D’abord pour justifier l’existence de ceux qui les diagnostiquent. Si demain n’était pas différent d’hier, qui accepterait de suffoquer sous la mélasse verbale des faux savants ? La « crise » valorise le caquetage incessant des médias et des experts.
Le Figaro interroge le crisologue Jacques Julliard : « Vivons-nous une crise des institutions, une crise de la démocratie, une crise de la civilisation ou les trois à la fois ? » (03.05.02) Et Julliard de répliquer par un poker de clichés : « Le peuple est devenu objectivement conservateur. Il a peur de l’évolution, de l’Europe, de la mondialisation, de la libération des mœurs. » D’une « crise », on attend le dénouement. Les rosses expirantes de l’attelage du PPA la prophétisent régulièrement. La version pessimiste fait surgir le spectre d’une démocratie mise à mal par les « peurs » (comprendre les « refus ») de l’Europe ou de la mondialisation, les « replis sur soi », les « passions » populaires (grèves), la perte des « valeurs », etc. Ces hypothèques, fruits d’un « déficit d’explications », seraient levées par un « effort pédagogique », un « débat d’idées », « citoyen » de préférence. Il enseignerait au peuple ce qu’il n’a pas « compris » : c’est, par exemple, au service du seul bien commun qu’entre 1998 et 2000 le patron de l’industrie du luxe Bernard Arnault a empoché chaque heure l’équivalent de 64 années de salaire d’un smicard. La version optimiste table plutôt sur une « mutation » bénéfique dont l’avènement exigera quelques menus « sacrifices » : le renoncement à ces « archaïsmes » que sont la protection sociale, les minima sociaux, le droit du travail, etc. Mais là encore, il faudra éduquer les masses. « Il y a toute une pédagogie qui n’est pas faite, et notamment une pédagogie du risque », insista Christine Ockrent, l’amie des patrons, après un reportage sur des jeunes qui se rebellaient contre la précarité de l’emploi (France 3, 22.04.01). Dès lors qu’une « crise » justifie des « remèdes » extraordinaires, la « crise de l’autorité » impose un renforcement autoritaire des autorités, sous la forme de cars de CRS dans les banlieues ; la « crise familiale » permet la suppression des allocations aux parents de délinquants ; la crise du « lien social » débouche sur des allégements de charges sociales en faveur des patrons. Et la « crise de l’impunité » se résout par la mise en place d’une justice expéditive pour les pauvres.    Lire la suite du dossier Lire la suite du dossier
|
| 
1. Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l’idéologie dominante », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2-3, 1976, p. 4 et 5.
2. Karl Marx et Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, Éditions sociales, 1982, p. 60.
3. François De Closets, Toujours plus, Grasset, 1982, p. 324
4. À l’époque, le PPA s’était regroupé dans une association, la Fondation Saint-Simon, qui rassemblait universitaires, patrons et journalistes.
5. « Vive la crise ! », supplément hors série au numéro 860 de Libération, février 1984.
6. Propos cités par Serge Halimi, Le Monde diplomatique, janvier 1996.
7. Laurent Mouchard et Philippe Tesson, Où est passée l’autorité ? Nil, 2000.
8. Claude Allègre au colloque de Villepinte, Des villes sûres pour des citoyens libres, Ministère de l’Intérieur, 1997, p. 31.
9. Christine Lazerges et Jean-Pierre Balduyck, Réponses à la délinquance des mineurs, La Documentation française, 1998, p. 20.
10. Michel Wieviorka, Violence en France, Seuil, 2000.
11. Martine Aubry, Des villes sûres pour des citoyens libres, op. cit., p. 37
|